Santé mentale des femmes : des inégalités invisibles mais bien réelles

Le 28 mai marque la Journée Internationale d’action pour la santé des Femmes. Loin d’être une date symbolique de plus dans le calendrier, elle rappelle que les inégalités de genre ont des conséquences directes (et encore trop souvent invisibles !) sur la santé, en particulier la santé mentale.
Car même si les discours sur l’égalité progressent sur le papier, la réalité reste pleine de décalages. Moindre accès aux postes à haute responsabilité, charge domestique toujours inégalement répartie, attentes sociales contradictoires, charge mentale parentale sous-estimée… Autant de facteurs qui génèrent un stress chronique et pèsent sur l’équilibre psychique.
Chez Qualisocial, on préfère parler solutions concrètes plutôt que constats fatalistes. Comprendre ce que vivent les femmes, c’est aussi mieux accompagner, mieux prévenir, et surtout : créer des environnements de travail qui respectent vraiment l’équilibre de chacun(e).
Selon le Baromètre Santé mentale & QVCT 2025 de Qualisocial x Ipsos, les femmes affichent un score QVCT inférieur de 15 % à celui des hommes.
- Sur la santé mentale, l’écart atteint -25,75 %.
- Le sentiment d’être écoutées et reconnues est 21,7 % plus faible.
- L’engagement émotionnel (envie, implication, fierté) est systématiquement entre 13 et 20 % plus bas.
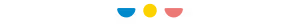
Des chiffres qui parlent : la double peine professionnelle pour les femmes
Parité affichée ne veut pas dire égalité vécue, et encore moins égalité ressentie. Aujourd’hui, moins de 20 % des membres de COMEX dans les entreprises du CAC 40 sont des femmes (source : Ethics & Boards, 2023). Et dans les conseils d’administration ? On progresse (merci les quotas ! 😅), mais l’écart reste marqué dès qu’on parle de pouvoir exécutif, de direction générale ou de présidence. Le plafond de verre n’a pas disparu, il a juste changé de texture. Il est moins frontal, plus subtil, mais tout aussi efficace pour freiner les parcours.Ce qui freine aussi, c’est le temps partiel, souvent présenté comme un choix… alors que dans les faits, il est subi pour près d’une femme sur trois en emploi à temps partiel (source : INSEE, 2023). Une organisation du travail qui réduit les opportunités d’évolution, les chances de prendre des responsabilités, voire de se former. Moins de perspectives = moins de projection = moins de confiance. Et ça, ce n’est pas juste un enjeu de carrière : c’est un véritable facteur de fatigue mentale.Même quand les femmes accèdent à des postes à responsabilité, la marche reste haute. Elles sont nombreuses à témoigner d’un sentiment de devoir “prouver plus”, d’en faire davantage pour être reconnues au même niveau que leurs homologues masculins. Et cette pression n’est pas que perçue : elle est vécue, quotidiennement, dans les échanges, les évaluations, les décisions qui traînent.Résultat : une charge mentale professionnelle qui vient s’ajouter au reste, avec un cocktail explosif bien connu de stress, d’auto-surveillance, et parfois de découragement. Surtout quand la reconnaissance ne suit pas.Pour ne rien arranger à la situation, notre Baromètre Santé mentale & QVCT 2025 en partenariat avec Ipsos révèle que les femmes évaluent leur QVCT 15 % moins positivement que les hommes, avec un écart maximal de près de 22 % sur la thématique de la reconnaissance et l’écoute (place donnée aux salariés).
Le poids de la charge domestique : un facteur clé de déséquilibre
Il y a le travail… et puis il y a tout ce qui vient avant, après, entre deux réunions et même parfois pendant les pauses déjeuner. Prévoir les repas de la semaine, gérer les lessives, penser aux sorties scolaires, commander un cadeau d’anniversaire à la dernière minute, coordonner les rendez-vous médicaux, la fameuse “to-do list invisible” qui ne prend jamais vraiment de pause.Et si on regarde les chiffres, cette charge-là repose encore très largement sur les femmes.68 % des tâches ménagères sont toujours réalisées par les femmes en France (source : Observatoire des inégalités, 2025). Oui, oui, même en 2025 ! Même dans les foyers où les deux parents travaillent à temps plein. Même avec des discours égalitaires bien rodés.Ce déséquilibre crée une deuxième journée de travail, que beaucoup ont intégrée sans même s’en rendre compte. On parle souvent d’”équilibre pro/perso” comme d’un idéal atteignable. Mais dans la réalité, c’est souvent une injonction implicite à tout faire, tout le temps, et bien.
La pression sociale d’être performante au travail ET irréprochable à la maison s’installe progressivement
Et comme la charge domestique est souvent silencieuse (et difficilement mesurable), elle reste largement invisible dans les politiques RH, alors même qu’elle impacte la concentration, l’énergie, le niveau de stress et le sentiment de surcharge.Ce qui est important ici, c’est de sortir de la culpabilisation individuelle : on ne manque pas d’organisation, on manque de relais. On ne “gère pas mal”, on gère trop, tout le temps.
Bonne nouvelle ; des solutions existent pour "apaiser" la santé mentale des femmes
- Quand les entreprises proposent plus de flexibilité réelle, pas juste sur le papier,
- Quand on valorise les résultats plutôt que la présence,
- Quand les congés maternité et paternité deviennent un sujet partagé (et partagé équitablement),
- Quand on intègre enfin cette fameuse “réalité du hors-bureau” dans les réflexions QVCT,
… Là alors, on commence à alléger la charge, pour de vrai.Parce que non, ce n’est pas “normal” de finir toutes ses journées épuisée, la tête pleine et le cœur en alerte. Et parce que repenser l’équilibre, c’est une condition pour durer, s’épanouir, et contribuer pleinement : au travail comme à la maison !
Une égalité de droit... mais pas de traitement
On parle beaucoup d'égalité des droits, et c’est un progrès indéniable. Mais qu’en est-il de l’égalité de traitement au quotidien ? Là, la réalité est un peu plus complexe.Prenons le télétravail, par exemple. Si de nombreuses entreprises l’ont adopté, il reste souvent un regard différent sur les femmes qui en bénéficient. Entre la culture du doute, parfois implicite, et le surcontrôle, elles se retrouvent sous pression. Ce n’est pas juste une question d’horaires ou de résultats, c’est une question de confiance. On leur demande parfois de "prouver" plus qu'à leurs collègues masculins, comme si leur productivité était moins évidente.La réalité est qu’elles sont souvent confrontées à des micro-agressions voir, des cas de harcèlement : ces petites remarques ou comportements qui semblent anodins, mais qui s’accumulent et laissent des traces. Elles sont aussi plus sujettes à des interruptions incessantes, voire à des biais inconscients, qui font qu’on les entend moins ou qu’on les désinvestit dans les décisions importantes.Tous ces petits gestes, même s’ils sont rarement intentionnels, construisent un climat de méfiance qui ronge lentement la confiance en soi. Et ce manque de légitimité, ce sentiment d’être sous-évaluée ou de devoir "s'effacer" pour être acceptée, peut avoir des effets dévastateurs à long terme.Mais plutôt que de se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, et de parler de stress ou d’anxiété (qui peuvent en effet être présents, mais trop souvent invisibilisés), chez Qualisocial, on préfère parler d'opportunités. Comment, à travers une culture plus inclusive et plus consciente de ces biais, peut-on libérer de la confiance et de la légitimité pour toutes et tous ?Les entreprises qui choisissent de se réinventer en ce sens créent des environnements où chaque collaborateur (homme comme femme !) peut s’épanouir sans avoir à prouver son efficacité. C’est en instaurant cette confiance mutuelle qu’on crée un cercle vertueux, où la performance ne dépend pas de la surveillance, mais de la reconnaissance de chacun(e) dans son rôle.
👀 Un contenu que la rédac a particulièrement aimé sur le sujet de la santé des femmes : le dossier dédié "santé des femmes au travail" de TheDailySwile. À dévorer, sans modération !

Pourquoi ces enjeux doivent être pris en compte dans les politiques de santé mentale en entreprise
La santé mentale reste encore un tabou dans beaucoup d’entreprises, et lorsqu'on l'aborde, l’aspect genré et systémique est souvent négligé. Pourtant, il est essentiel d’adopter une approche globale qui dépasse la simple gestion des symptômes, en prenant en compte les facteurs spécifiques qui influencent le bien-être des collaborateurs, notamment des femmes.L’idée n’est pas d’opposer performance et bien-être, bien au contraire. Reconnaître la complexité des parcours féminins et leurs spécificités devient un véritable levier de transformation pour l'entreprise. Lorsqu’une organisation valorise ces parcours, elle favorise non seulement le bien-être de ses collaborateurs mais aussi leur engagement et leur efficacité. La reconnaissance des défis propres à chaque individu, en particulier des femmes, et la prise en compte de leurs réalités quotidiennes, sont des atouts pour faire évoluer l'entreprise dans une direction positive.Il est crucial de redéfinir la performance : il ne s'agit pas uniquement de résultats quantifiables, mais aussi de bien-être, d'équilibre et de développement personnel. Une entreprise qui valorise cet équilibre crée un environnement propice à la productivité, où la santé mentale n'est pas un frein, mais un moteur de succès.

Finalement, et si on repensait la santé mentale en entreprise, avec plus de justesse et de nuances ? En prenant le temps d’écouter les vécus, en s’intéressant aux différences parfois invisibles, et en créant des environnements de travail qui tiennent vraiment compte de l’humain(e).Célébrer la Journée du 28 mai, c’est aussi ça : ouvrir les yeux sur ce qu’on peut améliorer, petit à petit, ensemble.Chez Qualisocial, on accompagne les entreprises qui veulent avancer dans ce sens, en proposant des solutions concrètes pour prendre soin de la santé mentale des salarié(e)s, femmes comme hommes. Des dispositifs pensés pour soutenir, prévenir, et faire grandir des cultures de travail plus saines et plus équilibrées.



%20(1).avif)
.avif)















