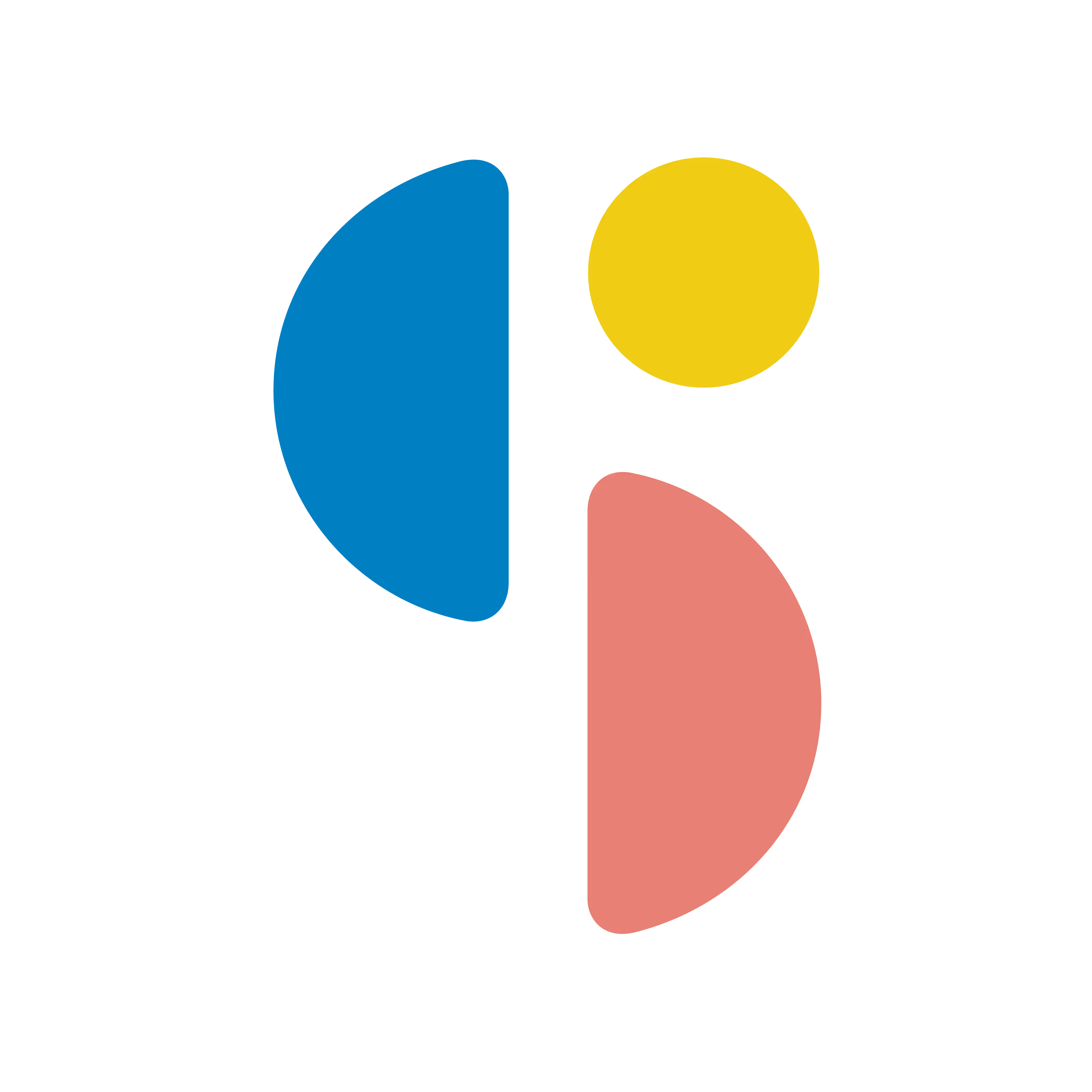Comment agir en cas de fort turn over dans son entreprise ?

Le turn-over représente un indicateur clé de la santé organisationnelle d’une entreprise. En 2023, le taux moyen de rotation du personnel en France s’établissait à 14,95%, marquant une baisse par rapport à 2022 (17,44%), mais restant supérieur aux niveaux pré-pandémiques . Cette dynamique engendre des coûts significatifs pour les entreprises, estimés à environ 33% du salaire annuel brut pour chaque remplacement de salarié . Parmi les facteurs influençant le turn-over, la santé mentale des employés joue un rôle crucial. La mise en place d’une cellule de soutien psychologique apparaît ainsi comme une stratégie efficace pour améliorer le bien-être des salariés et réduire la rotation du personnel.
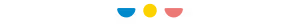
Comprendre le turn-over en entreprise
Définition et types de turn-over
Le turn-over désigne le renouvellement des effectifs au sein d'une entreprise sur une période donnée. Il peut être :
- Volontaire : résultant de démissions ou de départs à la retraite.
- Involontaire : lié à des licenciements ou des fins de contrat.
Causes fréquentes
Les causes du turn-over sont multiples :
- Conditions de travail difficiles.
- Manque de reconnaissance.
- Opportunités de carrière limitées.
- Problèmes de santé mentale non pris en charge.
Impact du turn-over sur l'entreprise
Coûts directs et indirects
Le remplacement d'un salarié peut coûter jusqu'à 33% de son salaire annuel brut, incluant les frais de recrutement, de formation et la perte de productivité .
Conséquences organisationnelles
Un turn-over élevé peut entraîner :
- Une baisse de la motivation des équipes.
- Une perte de savoir-faire.
- Une dégradation de l'image de l'entreprise.
Le coût du turnover pour les entreprises
Le turnover représente un coût important pour les entreprises, souvent sous-estimé dans les stratégies RH. Selon les données de l’Apec, le remplacement d’un cadre coûte en moyenne entre 15 000 et 25 000 euros, un montant qui comprend les coûts de recrutement, de formation, la perte de productivité, ainsi que l’impact organisationnel. Pour les non-cadres, ce coût reste significatif : l’étude Le coût du turnover publiée par Elevo en 2022 l’évalue à 10 000 euros minimum par départ, tous profils confondus.
Les secteurs ne sont pas tous égaux face à ce phénomène
L’hôtellerie-restauration, le commerce de détail et les services à la personne enregistrent des taux de rotation parmi les plus élevés, atteignant parfois plus de 50% de turnover annuel, selon une étude du cabinet Hays. À l’inverse, l’industrie ou la fonction publique affichent des taux plus bas, généralement inférieurs à 10 %. Ces différences tiennent notamment à la pénibilité, à la précarité des contrats, ou encore aux conditions de travail spécifiques à chaque domaine.
Ce phénomène a aussi une corrélation directe avec l’absentéisme, en particulier lorsqu’il est lié à des risques psychosociaux non pris en charge. Selon le Baromètre 2023 de Malakoff Humanis, l’absentéisme a coûté 25,9 milliards d’euros aux entreprises françaises en 2022. Ce chiffre en hausse est en grande partie porté par l’augmentation des arrêts de travail de longue durée pour épuisement professionnel ou troubles psychologiques. Le lien est clair : un salarié en souffrance, non accompagné, est davantage susceptible de s’absenter, puis de quitter l’entreprise. Dans ces cas, le turnover est la conséquence d’un environnement de travail dégradé.
La DARES (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) souligne d’ailleurs dans son étude de juin 2022 que les entreprises qui investissent dans la qualité de vie au travail, et notamment dans des dispositifs de soutien psychologique, constatent une baisse conjointe de l’absentéisme et du turnover. La mise en place de mesures concrètes de prévention comme une cellule de soutien psychologique peut donc avoir un impact mesurable sur la fidélisation des collaborateurs et la maîtrise des coûts RH.
La cellule de soutien psychologique : définition et objectifs
Qu'est-ce qu'une cellule de soutien psychologique ?
Il s'agit d'un dispositif mis en place au sein de l'entreprise pour offrir un soutien psychologique aux salariés confrontés à des difficultés personnelles ou professionnelles. Elle peut être composée de psychologues, de conseillers ou de professionnels de l'écoute.
Objectifs principaux
Les objectifs d'une cellule de soutien psychologique sont :
- Prévenir les risques psychosociaux.
- Améliorer le bien-être des salariés.
- Réduire l'absentéisme et le turn-over.
La mise en place d'une telle cellule nécessite plusieurs étapes :
L'évaluation des besoins permet d'identifier les problématiques spécifiques à l'entreprise. Ensuite, le choix du modèle implique de décider entre une cellule interne ou faire appel à des prestataires externes spécialisés. La communication est essentielle pour informer les salariés de l'existence du dispositif et des modalités d'accès. Enfin, le suivi et l'évaluation consistent à mesurer l'efficacité de la cellule et ajuster les actions en conséquence.
Les résistances internes et les freins à la mise en place d'une cellule de soutien psychologique
Malgré les avantages évidents d’une cellule de soutien psychologique, de nombreuses entreprises rencontrent des résistances internes à sa mise en place. Ces obstacles sont souvent d’ordre culturel ou financier, et peuvent se manifester aussi bien au niveau de la direction que des salariés.
Les réticences des directions RH : coût, tabou et culture d'entreprise
Le premier frein à l’instauration d’une cellule de soutien psychologique en entreprise réside souvent dans le coût perçu de l’investissement. Les directions RH peuvent estimer que les coûts liés à la mise en place d’une telle cellule (recrutement de professionnels qualifiés, coûts d’infrastructure, formation, communication) sont disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus. Selon une étude menée par Malakoff Humanis en 2022, près de 40% des entreprises admettent avoir du mal à justifier financièrement l’implémentation de dispositifs de soutien psychologique au travail. Ce frein est particulièrement prononcé dans les PME, qui manquent souvent de ressources pour déployer ce type d'initiatives.
Un autre frein important est le tabou entourant la santé mentale dans certaines entreprises. Bien que la prise en charge des risques psychosociaux (RPS) soit devenue une priorité réglementaire (via le Code du travail), certaines organisations conservent une culture d'entreprise qui minimise ou ignore l’importance des troubles psychologiques. Dans ces entreprises, parler de stress, d’épuisement professionnel ou de burn-out peut être perçu comme un signe de faiblesse, ce qui dissuade certains managers de promouvoir l’ouverture à ce type de dispositifs.
Enfin, certaines directions RH peuvent considérer qu’une cellule de soutien psychologique en entreprise est superflue ou ne correspond pas à leurs besoins, surtout dans des secteurs où la pression économique est forte ou dans des organisations très hiérarchisées où la priorité est donnée à la productivité.
Les freins chez les salariés : peur d’être stigmatisé et manque de confiance
Pour les salariés, le principal frein à l’utilisation d’une cellule de soutien psychologique reste la peur de la stigmatisation. Beaucoup d’employés craignent que leurs collègues ou leur hiérarchie ne voient leur recours à ce service comme un signe de fragilité ou d’incompétence. Selon une étude de l’Institut de Santé au Travail réalisée en 2021, 35% des salariés affirment qu’ils n’oseraient pas solliciter un soutien psychologique de peur d’être jugés par leurs collègues ou managers. Ce frein est particulièrement marqué dans des secteurs où la compétitivité est élevée ou où les employés sont soumis à des conditions de travail stressantes.
Un autre obstacle est le manque de confiance dans le système mis en place. Si la cellule de soutien psychologique n’est pas suffisamment anonyme ou transparente, les salariés peuvent craindre que leurs échanges ne soient pas protégés ou qu’ils puissent avoir des répercussions négatives sur leur carrière. De plus, si l’accompagnement proposé n’est pas adapté aux besoins individuels des salariés (par exemple, si le psychologue n’est pas suffisamment formé aux spécificités du milieu professionnel), l’impact de la cellule risque d’être limité.
Comment lever ces freins ?
Pour surmonter ces résistances et faciliter la mise en place d’une cellule de soutien psychologique, plusieurs leviers peuvent être activés, tant au niveau de la direction que des employés.
- Communication transparente et sensibilisation managériale : pour dissiper les craintes liées à la stigmatisation et au tabou, il est essentiel d’ouvrir le dialogue. La direction doit clairement communiquer sur l’objectif de la cellule de soutien psychologique : il ne s’agit pas de traiter des cas de "faiblesse", mais de prendre soin du bien-être psychologique des employés, ce qui est bénéfique pour l’organisation dans son ensemble. De plus, les managers doivent être formés à repérer les signes de souffrance psychologique et à encourager leurs équipes à utiliser les services proposés sans jugement. Une telle démarche dénormalise les tabous et favorise l’acceptation des dispositifs de soutien.
- Assurer l’anonymat et la confidentialité : pour rassurer les salariés, l’anonymat des échanges doit être garanti. L’accompagnement psychologique doit être totalement confidentiel, sans aucune trace dans les dossiers RH. Le recours à des prestataires externes, tels que des cabinets spécialisés en soutien psychologique, peut également renforcer cette dimension de sécurité et de confidentialité.
Témoignages et retours d’expérience : la direction peut organiser des séances d’information ou des témoignages anonymes de salariés ayant utilisé la cellule de soutien psychologique et en ayant tiré des bénéfices. Ces retours peuvent rassurer les autres employés et montrer concrètement les avantages d’un tel service. - Intégration progressive dans la culture d’entreprise : pour que la cellule de soutien psychologique soit perçue comme un outil à part entière de la politique RH, elle doit être intégrée progressivement dans la culture de l’entreprise. L’objectif est que le soutien psychologique soit perçu comme une démarche préventive, et non seulement comme une réponse aux crises. Pour ce faire, il est possible de l’associer à des actions de prévention des risques psychosociaux, comme des formations sur la gestion du stress ou des sessions de relaxation.

Bénéfices d’une cellule de soutien psychologique sur le turnover
La mise en place d'une cellule de soutien psychologique contribue à réduire le turnover en améliorant le bien-être des salariés, diminue l'absentéisme, et améliore la productivité et l'engagement des employés. En offrant un espace d'écoute et de soutien, les salariés se sentent valorisés et mieux accompagnés, ce qui renforce leur engagement envers l'entreprise.



%20(1).avif)
.avif)